| |
|
 |
Callac-de-Bretagne |
|
 Retour Retour
La Paysannerie bretonne après la Grande Guerre.
Introduction.
"La paysannerie constitue
bien un enjeu fondamental des affrontements politiques qui traversent la
Bretagne. Cette situation prend encore plus d’acuité au lendemain de la
Première Guerre mondiale, lorsque l’intégration de la région dans l’espace
national s’accélère tant sur le plan économique que culturel. Forte du « prix
du sang » payé durant la guerre, la paysannerie bretonne sort du conflit avec
une perception accrue de son identité et de sa place dans la nation. Le
décloisonnement socio-culturel qu’elle a vécu à cette occasion entraîne
notamment une volonté d’améliorer ses conditions de vie. L’affirmation des
aspirations paysannes s’impose désormais comme une donnée majeure dans la
société bretonne. Déjà observable dans les nombreux achats de terres rendus
possibles par la relative prospérité des années 1920, la montée des
préoccupations économiques au sein de la paysannerie se remarque également dans
le développement des structures syndicales et mutualistes qui l’accompagne..."
(Extrait de Ruralia- Bensoussan, David, 2005. Analyse du dorgerisme.)
L'article
que nous publions ci-dessous, avec l'aimable autorisation du responsable
de la Revue "Pays d'Argoat", Jean Paul Rolland, est un survol
authentique des conditions de la paysannerie bretonne de l'Argoat
profond, dans les années qui ont précédées et suivies la dernière
guerre. C'est donc une image de cette société rurale à jamais disparue,
images qui rappelleront aux derniers anciens encore vivants
aujourd'hui, les souvenirs d'une vie d'entraide, de labeurs et de joie
de vivre...
Source : Pays d'Argoat, Revue d'Histoire et d'Archéologie des cantons d'Argoat- N° 42- 2ème semestre 2004, pages23 à34.
Victor LE TERTRE, un homme,
un vrai paysan breton,
passionné des chevaux...

Victor Le Tertre, aîné d'une famille de sept enfants, est né à Kerellec
en Callac, le 17 janvier 1924. Il fréquenta l'école de Callac de l'âge
de six ans et demi jusqu'à l'obtention du Certificat d'Etudes Primaires
à treize ans ; une enfance, somme toute, pas très différente des
enfants de son âge, ni dans la pauvreté, ni dans l'opulence. Il s'est
marié, le 8 juin 1946.
" En début d’année scolaire, on m'achetait un costume de velours et
lorsque je revenais de l'école, le soir ou les jeudis, je revêtais
celui de l'année passée afin de préserver le neuf pour qu'il reste le
plus longtemps possible soigné. Ma grand-mère me tricotait des
chaussettes et une camisole, en laine de mouton, qui me préservaient du
froid. Le 7 juin 1937, j'ai passé le Certificat d'Etudes Primaires à
Callac où toutes les écoles du canton se rassemblaient. Il fallait se
présenter pour huit heures, heure à laquelle on procédait à l'appel. La
table qui nous était attribuée portait notre nom. On commençait par une
dictée, puis deux problèmes, ensuite une rédaction et pour finir un
dessin. Les classes étaient surveillées par les instituteurs ou
institutrices des communes du canton. A midi, il était à nouveau
procédé à l'appel et celui qui n'était pas nommé, était recalé
(rasket). Beaucoup d'élèves qui avaient échoués au certificat, ne
revenaient pas l'année suivante, ils rentraient directement dans la vie
active Les enfants de parents aisés allaient dans le secondaire à
Guingamp ou Morlaix, mais à quelques exceptions près, ceux des
campagnes allaient au travail. On m'avait dit : " tu iras à l'école
jusqu'à ton certificat et si tu l'as, on t'achètera une bicyclette ".
Après l'école, j'ai constamment lu car le maître d'école nous avait
bien dit : " lisez toujours un peu afin de ne pas oublier ".
A treize ans, je suis resté à la ferme. Je me suis passionné pour les
chevaux. Je conduisais, déjà, seul, un attelage de quatre chevaux
attelés à une charretée de fumier par les chemins creux qui étaient de
vraies fondrières, tellement que l'hiver, les pies des vaches
touchaient la boue ! Mais on s'arrangeait pour les pacager non loin de
l'étable, le plus souvent dans les champs où poussait de la lande
(étendue de terre où ne croissent que certaines plantes sauvages -
ajonc, bruyère, fougère, genêt...). Les chevaux étaient nourris
principalement d'ajonc haché, ou de betteraves coupées au couteau, et
d'un peu de foin. Parfois on gardait à l'étable des bêtes à engraisser
afin de les vendre un bon prix. On les nourrissait comme les cochons :
on cuisait du blé ou de l'orge concassé, des pommes de terre et des
rutabagas. Dans les fermes, on semait particulièrement de l’avoine, du
seigle et du blé noir dans les terres pauvres. L'ajonc a longtemps
constitué la nourriture des chevaux, il était semé au même titre que
les autres plantes. Exploitable au bout de deux ans ; c'était une
nourriture abondante qui ne nécessitait pas d'apports extérieurs, ni de
travail supplémentaire. Au bout de quatorze ou quinze ans, la fougère
commençait à prendre le dessus, le sol était épuisé, il fallait le "
refaire ". Les pieds d'ajonc étaient coupés à la faucille (falz troha
lann), on s'en servait comme bois de chauffage. Puis, avec un attelage
de six chevaux et un araire spécial (arar devonterez), on arrachait ou
coupait les racines. On affûtait, une ou deux fois par jour, les socs
afin de faire du bon travail et faciliter le travail des chevaux. On
refaisait ces champs d'ajonc au mois de mars, avec un attelage de six
chevaux et deux conducteurs : un à l'attelage avant et l'autre à
l'attelage arrière. Deux personnes manœuvraient l'araire : en
particulier au bout du champ : une personne était préposée à désengager
le soc de souches coincées, avec un crochet (was harpon), l'autre
manœuvrait l'araire. On laissait la terre pourrir un bon mois, on
ramassait les souches et les cailloux après avoir passé la herse (oged)
puis le cultivateur (diaoul). À la fin mai, sans mettre de
fumier, on semait du blé noir ou des rutabagas pour nettoyer la terre.
Dans les petites fermes qui ne disposaient pas de beaucoup de chevaux,
on défonçait la terre à l'aide d'une large tranche (ar war).
Les journées de travail duraient de 10 à 12 heures et l'été de 14 à 15
heures. Le matin, à 6 heures, j'allais chercher du trèfle pour les
bêtes : une charretée pour les chevaux et une autre pour les vaches.
Dès le mois de mars, je coupais de l'herbe tendre dans les prés sur
source, que je mélangeais ensuite avec de l'ajonc : l'herbe adoucissait
cet ajonc haché qui, à la sortie de l'hiver, après avoir subi le gel,
était coriace. Dès 1930, j'avais fait l'acquisition d'un moteur à
essence Japy pour faire tourner le broyeur d'ajonc ; les lames du
broyeur étaient affûtées toutes les semaines à la pierre à aiguiser ou
la lime si elles étaient trop esquintées On obtenait cette herbe tendre
et drue dans des prés bien orientés et abrités, en laissant l'eau de
source couler sur la prairie par le biais de rigoles que l'on obstruait
alternativement. Ces rigoles étaient refaites régulièrement avec une
faux spéciale (falc'hprat) que l'on faisait confectionner par le
forgeron, avec une vieille faux. Je n'avais évidemment pas de bottines
pour ce travail ; uniquement des sabots de bois garnis de paille que je
devais changer lorsque je rentrai à la maison pour ne pas rester les
pieds mouillés. Le pire avec les sabots de bois (botou koad) était
lorsque l'on travaillait dans des parcelles où la terre était mouillée
et glaiseuse. La glaise s'accrochait au bois, parfois rentrait à
l'intérieur, les sabots s'alourdissaient de moitié : la marche devenait
maladroite et pénible, et, occasionnellement le cheval marchait dessus
et l'éclatait malgré la frette qui maintenait le coup de pied !
Après l'herbe, à la mi-avril. Je commençais à couper du seigle (segal)
vert que je mélangeais à l'ajonc. pendant environ trois semaines à un
mois, ensuite commençait l'épiaison ainsi il devenait trop dur. Pour
remplacer ce seigle coupé, on semait des pommes de terre. Puis venait
le trèfle rouge (melchon ruz) que parfois on avait semé avec le seigle.
Ce trèfle (blanc ou rouge) précoce et retard était une excellente
nourriture pour les animaux ; le trèfle rouge retard durait jusqu'à la
mi-juin puis lui succédait le trèfle violet que l'on coupait jusqu'aux
environs de la foire de Bulat car, lorsque venaient les premières
gelées. il noircissait. Après la récolte, on passait le cultivateur
ensuite la herse. On ne labourait pas très profond, les outils ne le
permettaient pas. Dans les petites fermes. on n'attelait que deux
chevaux sur les outils par contre. dans les grandes fermes. où les
champs étaient plus grands, trois à quatre chevaux étaient couramment
utilisés sur les charrues pour retourner la terre. Il fallait compter
une journée pour labourer un demi hectare d'où l'expression en breton
(ar devezh arat). Après l'arrachage des pommes de terre et des
betteraves. on semait le blé d'hiver. L'avoine était semée dans les
huit premiers jours de novembre.
La fenaison et la moisson étaient coupées à la faucheuse. Dans les prés
humides, la solidarité inter-villageoise existait vraiment. Il n'était
pas rare de voir jusqu'à une vingtaine de faucheurs. de tout âge, dans
certains grands prés. Dès l'âge de 14-15 ans. je faisais partie de ces
groupes. Ces journées étaient très éprouvantes pour les corps car une
certaine émulation existait entre les personnes et il ne fallait pas
perdre la face ! Les faucheurs tenaient à avoir une bonne faux bien
aiguisée sinon ils étaient obligés de " forcer " ; ils s'appliquaient à
la battre (ipilatti) pour avoir le meilleur tranchant et de temps à
temps, il levait le dos pour passer la pierre à affûter (mein lemma)
pour lui refaire son fil. La journée commençait à 7 heures du matin,
directement dans le pré, puis vers 9 heures 30, la maîtresse de maison
apportait le casse- croûte, parfois en charrette lorsque le pré était
loin de la maison. Inutile de vous dire que les ouvriers étaient à ce
moment-là en appétit ! Il n'y avait pas beaucoup de taupinières dans
ces prés, on les retrouvait plus dans les champs (foenn tirien) où
l'herbe était plus rase, " l'herbe rousse " comme disaient les anciens.
Les prés avaient un fond humide ce qui facilitait la coupe. Cependant,
lorsqu'un novice ou un faucheur prenait une bande trop large et que la
faux ne prenait pas le foin à la base, cela se voyait.
Lorsque l'herbe était coupée, les femmes intervenaient pour faner afin
de faciliter le séchage (direstan). Quand l'herbe était devenue foin,
elles le mettaient en andains (rodelli) puis en tas, et parfois le
déplaçaient : si la zone était trop humide. Quand le temps menaçait, on
ramassait le foin directement sans le mettre en tas, le travail était
plus pénible pour celui qui chargeait et celui qui faisait la charretée
car le foin n'était pas compact. A la maison, deux hommes d'expérience
étaient préposés à l'édification de la meule de foin afin de s'assurer
que l'eau de pluie ne pénètre pas dedans. Le fermier avait auparavant
constitué l'emplacement, souvent bien abrité des vents dominants
derrière de grands arbres, en disposant des traverses de bois
recouvertes de fagots (zigen). A l'automne, il la recouvrait de paille
ou mieux avec du carex (hesk) vert qu'il faisait tenir avec des
branches de saule liées les unes aux autres. De même que les maisons
étaient souvent protégées du vent dominant et de la pluie par de grands
ifs"[1] (10 à 15 mètres de haut) (ivin). Souvent quand je retournais la
terre aux abords du village, la charrue rencontrait les racines d'ormes
(tilh) ou de frênes (onn), les chevaux s’arrêtaient, mais parfois, le
soc cassait !
La moisson (eost) était aussi un moment intense dans la vie de la
ferme. On faisait le tour du champ à la faux, puis on disposait les
javelles (dramm) le long du talus. La faucheuse (troc'herez) entrait
ensuite en action : certaines grandes fermes disposaient de faucheuse
lieuse (lieuz). Après la seconde guerre mondiale, cette machine était
présente dans beaucoup de fermes, elle a perduré une quinzaine d'années
puis la relève a été faite par la moissonneuse batteuse. On ne traitait
pas le blé comme de nos jours : on enlevait d'abord, à la main, les
chardons et le rumex. Ainsi, les terres n'étaient pas aussi " sales "
que maintenant. Deux personnes sur la faucheuse : un conduisait les
chevaux, l'autre, avec une perche de bois. relevait, si nécessaire,
les épis, et, avec un dispositif mécanique. il constituait les
javelles. Plusieurs personnes liaient les javelles (veuskenn), elles
les
mettaient en moyettes afin de faciliter le séchage, pendant une petite
semaine. Puis les charroyaient vers l'aire à battre où on constituait
la meule (oustel). Bien souvent nous étions tributaires du climat,
comme
en 1946, où il a fallu défaire les gerbes afin de faire sécher la
paille - dans certains endroits le blé avait commencé à germer
tellement que les gerbes s'accrochaient les unes aux autres! On avait
eu de la misère cette année-là ! Ceux qui avaient réussi à battre leur
moisson, se devaient. encore. de remuer, tous les jours, le grain sur
les greniers, pour qu'il ne s'échauffe pas et ne devienne incomestible.
Les battages se faisaient d'abord dans les petites fermes qui souvent,
n'avaient que trois ou quatre hectares de moisson : les grandes fermes
avaient de huit à dix hectares, en particulier quatre à cinq hectares
d'avoine pour nourrir les chevaux. Ces journées n'étaient pas très
dures car il y avait beaucoup de monde. On se retrouvait entre vingt et
vingt-cinq personnes du village ou des alentours. Avant la seconde
guerre mondiale. les batteuses (dornerez) que l'on utilisait étaient
fréquemment de marque Gelard fabriquées à Guingamp, elles étaient mues
par des moteurs à essence : ensuite après-guerre, on les faisait
fonctionner avec des tracteurs Société Française ou " Vandœuvre " dans
les environs de Callac. Les villages, groupés par quatre ou cinq,
s'entraidaient. Ces journées devenaient rapidement de grands moments de
convivialité et de divertissement favorisés et souvent grisés par
l'absorption, dans les grandes fermes, d'une barrique de cidre ! Il
arrivait parfois qu'il y avait mésentente ou trouble entre quelques
familles ainsi on voyait se former une autre équipe dans le village.
Ces équipes formées comprenaient fréquemment de jeunes gens, garçons et
filles. Ces rencontres donnaient lieu à des aventures sentimentales ou
parfois des liaisons plus sérieuses. Les femmes approchaient les gerbes
sur la meule, coupaient les liens, surveillaient le remplissage des
sacs de grain, ramassaient la balle et les plus expertes, au fourneau,
préparaient le repas. Les hommes alimentaient la batteuse. portaient le
grain au grenier, la paille (plouz) au tas (bern) lorsque la meule était
large et haute, un jeune homme souple était désigné pour aller
alimenter la machine. Autour de la mécanique, en général le
propriétaire du matériel, s'affairait et surveillait le bon
fonctionnement. Bien que l'installation soit relativement dangereuse,
par manque de protection autour de cette multitude de courroies, je
n'ai jamais eu connaissance d'accident. Ceux qui avaient, en fin
d'après-midi, abusé de la dive bouteille de cidre, étaient surveillés
de près par les autres ouvriers plus raisonnables. Les journées
commençaient vers les huit heures ; le chantier, parfois, faisait deux
ou trois lieux, les responsables profitaient du déjeuner pour changer
de place à la batteuse. Ce n'est pas pour ça que l'équipe restait
traîner à table. Parfois le cultivateur allait à la coopérative
chercher des sacs de jute, d'une contenance de cent kilos. Lorsqu'ils
étaient pleins, on les mettait directement dans une charrette et ils
étaient livrés à la coopérative. Le grain était le plus souvent stocké
dans le grenier de la maison.
La balle d'avoine, propulsée le plus loin possible de la batteuse,
était ramassée et servait à regarnir les matelas pour l'hiver. Des gens
de la ville venaient souvent s'approvisionner de cette balle. Celle qui
tombait le plus près de la machine, était conservée dans un appentis,
afin de la ventiler et de récupérer les graines qui avaient échappées à
la mécanique. La balle de blé était également ramassée : on la donnait
à manger, sur les betteraves, aux bêtes. On ne perdait rien, les
résidus étaient étalés dans les prés afin qu'ils pourrissent ; ainsi
les champs restaient relativement propres.
L'hiver, on organisait des journées pour faire des fagots. L'ouvrier se
devait de trouver les liens, lui-même, environ une centaine pour une
journée. Il les choisissait de préférence dans les buissons de
noisetiers, de deux ans d'âge, de la grosseur d'un pouce, et, les
mettait à l'abri des regards pour de ne pas se les faire voler. On
coupait de vieilles souches sur les talus avec une hache : pour les
plus grosses, on utilisait le passe partout (harpon). En fait, lorsque
l'on était fermier, on n'avait le droit de couper que le bois qui avait
repoussé en neuf ans, c'est-à-dire en un bail de fermage. Par contre
tous les ans, à la faucille, on coupait les ronces et la fougère
(divac'harezh) sur les talus afin d'en faire de la litière.
Dans les grandes fermes, il y avait un journalier payé ; sa femme
restait à la maison, elle élevait une ou deux vaches et engraissait un
cochon. Dans les fermes, les personnes les moins valides, restaient
soigner les bêtes. Tous les jours, il fallait enlever le fumier dans
les étables et les écuries, mettre de la nourriture dans les mangeoires
et du foin dans les râteliers, tirer de l'eau du puits pour les
abreuver...
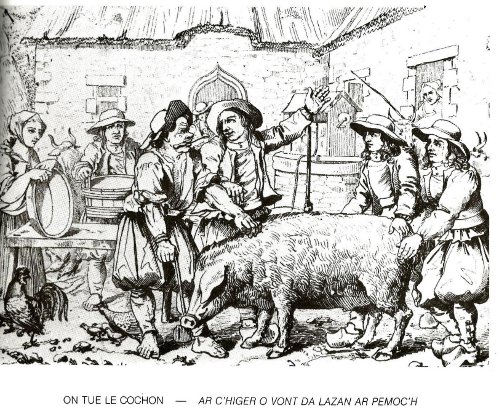
Dans les champs, le travail ne manquait pas non plus, on
mettait beaucoup de pommes de terre pour nourrir les cochons, et des
rutabagas, des betteraves qu'il fallait éclaircir et biner. Même les
enfants contribuaient à la vie de la ferme, en particulier à la garde
des vaches. Certaines familles nombreuses envoyaient quelques enfants,
pour leur nourriture et un petit pourboire, comme pâtre (paotr saout)
dans des fermes plus aisées. Les enfants étaient également sollicités
le jour du concours pour tenir la bride des juments et des pouliches.
De là, souvent, naissait l'affection des hommes pour les chevaux. Les
petites fermes faisaient paître leurs vaches sur le bord des routes ou
sur les issues communales. Quant aux chevaux, ils avaient droit à plus
d'égard et de considération ; on leur donnait à manger à l'écurie ou
alors ils avaient un champ à eux seuls. On les entravait pour qu'ils ne
s'échappent pas et qu'ils soient, toujours à proximité.
J'ai commencé très jeune à conduire les chevaux. Tout d'abord, à faire
des rangs et buter les pommes de terre. préparer la terre à recevoir
des betteraves, à conduire la faucheuse... Il est vrai que les chevaux
étaient dociles parce qu'attelés tous les jours. On commençait à les
atteler à l'âge de dix-huit mois, soit avec leur mère ou avec un ou une
autre qui avait l'habitude. A deux ans, on les attelait dans les
brancards de la charrette en particulier lorsqu'il y avait le charroi
du fumier destiné aux légumes. Dans l'ensemble, les chevaux étaient
doux et obéissants : je n'ai connu qu'une seule personne qui avait
coutume d'en avoir de méchants parce qu'il les achetait à bas prix. Il
les employait principalement pour les charrois de cailloux lors de la
réfection des routes. Pour les entraver, il était obligé de prendre une
fourche pour les maîtriser. Dans certaines fermes. les chevaux ne
toléraient que les personnes de leur entourage. Les gens qui
gravitaient autour des chevaux étaient rarement pris au dépourvu. ils
connaissaient bien la race chevaline, il fallait se méfier de se faire
mordre, les ruades étaient exceptionnelles. A l'exception, lorsqu'une
jument avait pouliné, il ne fallait pas aller autour d'elle, le poulain
était suffisamment autonome pour aller téter. Par contre, elle se
laissait approcher lorsqu'elle ou le poulain étaient malades. Les
étalons, d'ordinaire, étaient plus faciles d'accès.
Le bourrelier, tous les ans. venait dans les fermes, passer les harnais
en révision. Selon l'importance des fermes il demeurait deux, trois ou
huit jours. Certaines fermes lorsqu'elles tuaient une bête à cornes,
faisaient tanner à façon la peau dans les tanneries Le Brun ou Guillou
de Callac afin de disposer de cuir pour la réparation des harnais.
Evidemment, j'ai beaucoup pratiqué avec les chevaux et dormi avec
eux
dans l'écurie dans l'attente des poulinages. Après avoir attendu onze
mois un poulain, on ne laissait jamais une jument sans surveillance. En
dix minutes, elle pouvait faire son petit qui pouvait mourir étouffé
dans son placenta (gwele). Ainsi l'année pouvait être perdue, pour
quelques minutes d'inattention. On s’arrangeait pour mettre la jument
dans une position adéquate et surtout qu'elle ne puisse se mettre de
travers. Beaucoup d'efforts lui étaient nécessaire pour expulser le
poulain. Il m'est arrivé de voir une jument qui ne pouvait faire son
poulain. le petit et la mère mourraient. A Callac, il n'y avait qu'un
seul vétérinaire, Mariette, une vraie force de la nature, qui assumait
sa fonction souvent au-delà du canton. Dans les fermes, on ne le
sollicitait qu'en cas d'extrême nécessité car l'argent faisait défaut.
Mais à la saison des poulinages, en particulier de mars à mai, il ne
dormait pas souvent dans son lit. On le prévenait comme on pouvait, le
téléphone n'était pas monnaie courante, on se rendait à son domicile à
bicyclette, on avisait sa femme et ensuite il arrivait avec son
automobile. Parfois il était obligé de laisser sa voiture à une bonne
distance de la ferme, venir à pied, tellement le chemin était
impraticable. Quand le poulinage se passait mal, il sauvait la jument,
coupait le poulain dans le ventre de sa mère, morceaux par morceaux.
Pour les vaches, il procédait de même.
Les juments étaient conduites au mâle à la station des haras à Callac,
mais, dans certaines fermes, il y avait également des étalons approuvés
et encartés (carte rose) afin de les différencier de ceux de Lamballe.
Les haras ont été institués pour mieux contrôler la race chevaline et
ainsi concurrencer le privé. Ceux de Callac ont été créés en 1903, dans
la cour " Pierre Ogès " (aujourd'hui la cour du bar des sports). Au
début, les cultivateurs étaient assez réticents à s'y rendre. Après la
guerre 1914-18, dans les années 1920-23, les cultivateurs avaient pris
l'habitude d'y venir avec leurs juments (on en a compté jusqu'à
1500-1600, de tout le canton), les faire saillir par les 7 ou 8 étalons
disponibles. Les haras de Callac avaient une très bonne réputation dans
toute la Bretagne, en particulier les saillis des étalons Vermouth
(1924), Ufry, Naous (1938) [2], Combien, Lunatic, Calbanum....Puis en
1920, les haras se sont déplacés dans l'ancienne caserne de la
gendarmerie (maintenant remplacée par des HLM en bas de la rue de
l'Allée). Les haras actuels ont été construits en 1958.
J'ai fréquenté beaucoup de foires aux chevaux dès mon plus jeune âge. Les foires se déroulaient à :
- Callac : le troisième jeudi de février, la première ; puis tous les trois mois.
- Carhaix : le 13
mars, était une des plus grandes du secteur, ainsi que le lendemain de
la Toussaint (foar hanter wares).
- Loguivy-Plougras : la foire de St Emillion à Pâques.
- Park ar Mest en Pont Melvez : le lendemain du jeudi de l'Ascension.
- au Ménez Bré : le 17 juin, les 2 et 3 août puis au commencement d'octobre.
- Bulat : le lundi après le deuxième dimanche de septembre.
- Kérien : le 23 octobre, elle avait moins de notoriété car moins vieille[3].
- Guingamp : la veille de Noël ainsi que la fête des Rameaux.
- de Bod à Rostrenen : le
premier mardi de décembre [4] que l'on appelait également la foire de la
dernière chance (celle de vendre un bon prix son poulain de l’année).
Toutes ces foires avaient leurs spécificités, tant dans la qualité
des
animaux présentés, que l'origine des maquignons ou de la destination
des bêtes. Ainsi à Carhaix, la foire se déroulait autour de l'église.
Deux ou trois jours avant, des maquignons de toute la France [5]
arrivaient en prospection. Ceux qui avaient des bêtes à vendre. le
faisaient savoir aux hôteliers pour qu'ils répercutent l'information et
indiquent les adresses des fermes. Ces acheteurs essayaient de faire
affaire au départ de la ferme, souvent en minimisant le prix d'achat,
mais c'était sans compter sur la sagacité des vendeurs qui
fréquentaient habituellement les foires environnantes et connaissaient
les prix pratiqués. Ainsi. le 13 mars, on pouvait trouver, plus
spécifiquement, des étalons qui n'avaient plus droit de faire la monte,
reconnaissables à la lettre " R [6] tatouée sur le cou après avoir été
approuvés par une commission de réforme. Ils étaient pour la plupart
castrés et étaient souvent acquis pour aller travailler dans les
plaines du bassin parisien. On trouvait également des poulains qui
n'avaient pas trouvé preneur l'année passée et qui avaient été
engraissés tout l'hiver. Ces chevaux vendus étaient expédiés dans toute
la France par wagons à la gare.
A Callac, venaient, plus particulièrement. des marchands de chevaux du Léon, en particulier de Landivisiau.
Je suis allé à la foire du Ménez Bré pour la première fois à l'âge de
quatorze ans. J'avais deux pouliches attachées à l'arrière du char à
bancs et un étalon castré dans les brancards. J'étais parti de Callac
vers les trois heures, trois heures et demie du matin. pour parcourir
les vingt-cinq kilomètres et arriver à une bonne heure, là-haut sur la
colline. La foire commençait vers les dix heures. Mais à deux ou trois
kilomètres de la foire. les marchands étaient déjà sur la route, à
flairer la bonne affaire. Ce jour-là. J’ai vendu mes pouliches et
l'étalon. Il m’a fallu trouver une personne des environs de Callac, qui
rentrait chezlui avec sa jument, pour me ramener mon char à banc !
La veille de la
foire, ces maquignons étaient également dans les campagnes
environnantes, ils essayaient d'embobiner quelques-uns ou de faire leur
choix : c'était leur métier ! Evidemment sur le foirail, il y avait
toutes sortes de chevaux. Ceux qui étaient destinés au travail, les
marchands exigeaient qu'on les attelle afin de voir les réactions de
l'animal ; ils faisaient aussi signer, au vendeur, un document sur
lequel il était mentionné : " franc de collier et doux de l'homme ".
Comme à Pont Melvez, à Park ar Mest, il y avait une ferme, la
Commanderie, où tu payais, 20 sous, et on te prêtait des harnais et une
charrette. On serrait le frein pour voir si les chevaux répondaient aux
ordres. La foire, pour treize heures trente-quatorze heures, était
terminée. Les marchands, comme Combot, Yves Hélary, avaient acheté les
chevaux dont ils avaient besoin en premier choix ; il ne restait plus
que les petits trafiquants qui achetaient avec des personnes qui
avaient vraiment nécessité de vendre, souvent à petit prix. Ces bêtes
étaient appelées : " petite moyenne ". La négociation des chevaux, dans
le bruit, les engueulades bonne enfant, était scellée par des frappes
vigoureuses dans les mains. Ces grands marchands étaient de fins
connaisseurs, ils avaient du métier et connaissaient bien les chevaux
sous tous rapports, ils ne tardaient pas à découvrir un vice caché. Les
chevaux étaient évacués par les finistériens, en camions de transport
Miossec de Landivisiau, il faisait deux voyages dans la journée. Les
autres partaient à pied, en convoi, les uns accrochés aux autres par la
queue et le licol, par des conducteurs qui ne faisaient que cela
(toucher kezeg), soit jusqu'aux gares ferroviaires de Guingamp ou de
Belle Isle-Bégard. Sur le foirail, on trouvait également des personnes
qui faisaient métier de la castration des étalons, suite à une vente.
Au mois d'Août, il y avait déjà des poulains dès le troisième jeudi
d'Août à Callac ; les petits fermiers proposaient déjà des poulains de
l'année qu'ils voulaient vendre impérativement. Un poulain était sevré
au bout de six mois : par manque d'espace dans les bâtiments de ces
petites fermes, on ne pouvait pas le garder d'une part et d'autre part,
en le vendant, on disposait d'une certaine somme d'argent qui
contribuait à payer la St Michel. Les juments perdaient assez vite leur
lait, les poulains ainsi sevrés allaient dans les fermes qui savaient
comment faire pour les élever. La foire de Bulat également, était
l'occasion de vendre ces poulains : la dernière étant celle de Bod à
Rostrenen, sinon il fallait les ramener à la ferme et les nourrir en
attendant la prochaine foire de Callac ou Carhaix. On les gardait à
l'écurie, sans trop les sortir afin qu'ils soient bien gras au sortir
de l'hiver en les alimentant en " barbotages ", et les meilleurs avec
de l'ajonc et de l'herbe. On les nourrissait le mieux possible,
évidemment pour en obtenir un prix supérieur. Les grands maquignons du
Finistère[7] connaissaient les bons éleveurs du coin et tentaient souvent
de réserver. par des compromis de vente, les poulains, lorsque la
saillie avait été faite par un étalon de renom.
Les palefreniers (jusqu'à six) sous les ordres d'un adjudant logeaient
dans l'ancienne gendarmerie. Le premier. que j’aie connu, s'appelait
Fautrel. Il fut remplacé par Morin qui menait son haras de main de
maître. Il pouvait nourrir ses étalons pour rien, pendant cinq ou six
semaines, les grands cultivateurs du secteur lui fournissaient du
trèfle: mais lorsqu'ils rejoignaient Lamballe, les étalons retrouvaient
le régime haras : une ration d'avoine et du foin.
Les cultivateurs aimaient leurs chevaux : c'était leur plus grosse
source de revenus lorsqu'il y avait de bons poulains. Pendant la
seconde guerre mondiale, un poulain valait autant que sept ou huit
vaches, à savoir 30 ou 40000 Francs (anciens). Les poulains n'étaient
pas vendus pour la boucherie, à quelques exceptions près. ils étaient
sollicités dans beaucoup de pays étrangers.
Lors du concours de pouliches [8](ebeuleuz) de un, deux et trois ans à
Callac, au mois de mars. il y avait jusqu'à 120 sujets, évidemment les
meilleurs, car il en restait autant dans les fermes. On constituait des
pelotons d'une vingtaine de sujets. Dans le premier. se trouvaient les
meilleures pouliches, puis dans les autres par ordre de valeur. Au mois
d'Août, il y avait un autre concours de poulinières[9] (gazec-eubel)
suitées (la mère et son poulain). A ce moment-là, on ne parlait pas de
jument suitée, ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que l'on a
institué cette situation afin de conserver le maximum de spécimens. La
présentation se faisait à côté de l'église et le cercle se faisait sur
la place à côté de chez Fercoq. Les concours étaient très prisés, ceux
qui pouvaient gagner un prix (une dizaine étaient octroyés) étaient
récompensés financièrement. L'élevage des chevaux était un peu comme une
loterie, les éleveurs ne réussissaient pas à tous les coups. Le
concours départemental se tenait à St Brieuc, mais il n'y avait pas
autant de chevaux que maintenant. On chargeait les chevaux dans les
wagons du train Carhaix Guingamp qui était à voie métrique. On les
déchargeait à Guingamp puis rechargeait dans un wagon, d'un train à
voie normale, qui nous conduisait à St Brieuc où le rassemblement se
faisait sur la place Robien. On ne présentait que des pouliches de
trois ans : c'était le fleuron des futures poulinières. Elles n'étaient
pas à vendre, leur propriétaire les conservait afin d'avoir des
poulains à négocier. Le concours régional se déroulait à Lamballe,
quelquefois à Hennebont, à Landivisiau ou Pontivy. J'ai eu une jument
de trois ans qui fut présentée en 1947 à Pontivy, elle a terminé
première après plusieurs péripéties. Astrey était fille de Oustic, en
compétition avec une autre jument dénommée Arvel (appartenant à un
finistérien influent dans le milieu chevalin). Astrey fut déclarée
première, mais, le jury ne pouvant se mettre d'accord ; on convoqua un
second jury pour le départager, celui-ci classa Astrey première sous
les applaudissements du public et le mécontentement du grand
responsable finistérien. Ce n'était pas le tout de concourir, mais
parfois une certaine animosité s'établissait entre les éleveurs.
Ce fut toujours un grand plaisir pour moi de travailler près des
chevaux. Tous ceux qui aiment les chevaux, savent que cette passion ne
s'atténue pas avec les années ! "
Rolland Jean Paul.
Texte établi d'après une émission diffusée par RKB (Radio Kreiz Breizh).
Remerciements à Jean Pierre Guyader qui m'a communiqué l'interview et facilité la traduction en breton de ces quelques mots.
Notes.
[1] L'if avait également la particularité d'absorber les escarbilles
sortant des cheminées et ainsi d'éviter de mettre le feu dans les
toitures qui ont été longtemps couvertes de chaume. Ces grands ifs ont,
malheureusement, failli disparaître en 1997, en toute légalité, à cause
de la cupidité de certains hommes ! En 1663, Colbert établit un décret
qui ordonna d'associer un if à toute maison en construction, afin de
pouvoir disposer de bois lors de la construction de sa Marine. On
appelait cela de la politique à long terme !
[2] Un moulage de bronze représente ce cheval, né le 28 mars 1935 en
Loire Atlantique de Uvry et Sablet. Ce cheval de trait breton a donné
naissance à quelques 800 descendants directs. Acheté à l'âge de 3ans,
il fut d'abord affecté au dépôt de Lamballe, puis à la station de
Callac. Durant 13 ans de bons et loyaux services, il fut l'étalon le
plus réputé de Bretagne et c'est en son honneur que le sculpteur
animalier Guyot, après moulage en 1958, érigea sa statue fondue à Paris
chez Susse.
[3] Voir N° 38 de Pays d'Argoat. Historique de la foire de Kérien.
[4] On disait que celui qui allait faire la foire de Bod. sans
nécessité, était fou. Il est vrai que le temps était fréquemment
exécrable !
[5] Depuis le début du 19'me siècle. le monde entier connaît le Postier
breton (issu du croisement des juments du Léon avec des étalons Norfolk
anglais) L'apogée des exportations se situe dans les années 1900-1940.
[6] Pour réformé.
[7] On dit, qu'avant-guerre, ils achetaient les chevaux plus chers que
les autres. Ils donnaient la moitié du prix le jour de la foire et
l'autre moitié après avoir testé l'animal. Les cultivateurs se
rendaient ensuite dans le Léon récupérer leur dit Mais souvent ils
leur rétorquaient que leur cheval était soit gourmeux (maladie
spécifique du cheval caractérisée par une inflammation des voies
respiratoires, donnant lieu à la toux, à une forte fièvre, à une
abondante sécrétion catarrhale) ou boiteux et ainsi le prix était revu
à la baisse. Le docteur Mariette avait mis fin à cette malhonnêteté. :
Suite à une transaction de ce type, il se rendit dans le Léon avec le
vendeur d'une jument qu'il garantissait sans défaut. Lorsqu'ils
arrivèrent chez le maquignon, la jument était gourmeuse ! Muni d'un
revolver, Mariette abattit la jument et l'autopsia et trouva dar ses
bronches de petites plumes de volaille qui lorsque l'air passait
pouvaient faire penser à un cheval gourmeux. Pour le boîtage, il
suffisait de mettre un clou un peu de travers dans les chairs.
[8] Jument qui n'est pas encore adulte mais qui n'est plus un poulain
jusqu'à l'âge de trois ans où elle se faisait saillir pour la première
fois.
[9] Jument poulinière, destinée à la reproduction.
Joseph Lohou (janvier 2019) Mise à Jour
|
|
©
Tous Droits Réservés (Joseph Lohou)

|
